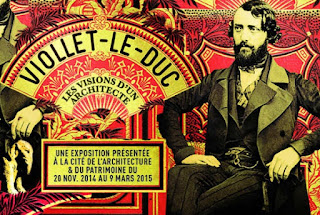En tant que lecteur de revues et visiteurs d'expositions d'architecture, on peut parfois être étonné, et souvent séduit, d'avoir à faire à un déploiement de théories extraordinairement sophistiquées, comme s'il était impossible de concevoir ou de comprendre un bâtiment sans maîtriser la french theory sur le bout des doigts. C'est notamment le cas de presque toutes les expositions consacrées par la Cité de l'architecture ou par le Pavillon de l'Arsenal à des œuvres contemporaines. Mais ce n'est pas du tout l'impression qui se dégage de la grande exposition patrimoniale de l'été de la Cité, consacrée aux représentations de l'architecte à travers l'histoire.
Le parcours de cette exposition est surtout centré sur la France, il
est essentiellement chronologique au début puis de plus en plus
thématique et fait une large place à la culture populaire pour ce qui
concerne l'époque contemporaine notamment. Une seule salle est consacrée à de rapides références aux architectes de l'Antiquité et du Moyen Âge. Ensuite, de la Renaissance à la fin du dix-neuvième siècle, les portraits d'architectes permettent de bien comprendre comment l'architecte se distingue progressivement du maître maçon, comment il se fait, souvent, théoricien en même temps que maître d’œuvre. Le vingtième siècle est traité de manière beaucoup plus anecdotique : dans des salles ornées de citations du philosophe Alain mais aussi de Michel Galabru, on peut par exemple voir une collection des pipes et lunettes de Le Corbusier, avant d'enchaîner sur de petits espaces consacrés à l'architecte sur les timbres et sur les billets de banque, l'architecte à la une de la presse, en bande
dessinée et au cinéma. Jacques Tati est évoqué, mais pas pour sa vision de l'architecture dans Mon Oncle ou Playtime, il l'est uniquement à travers une affiche des Vacances de Monsieur Hulot (1953), parce qu'il se serait, pour le personnage principal de ce film, inspiré de son voisin architecte (voisin dont le cartel de l'affiche nous précise inutilement qu'il était, voisin qui était le grand-père de l'actuel ministre de l'écologie). Quant à l’œuvre la plus citée dans la section cinéma et même dans l'ensemble de l'exposition, il s'agit d'Astérix et Obélix : mission Cléopâtre (2002), comédie d'Alain Chabat de 2002 dans laquelle Jamel Debouzze et Gérard Darmon incarnent Numérobis et Amonbofis, deux architectes au service de Cléopâtre ; une comédie couronnée de succès mais qui accumule, sur les architectes, les clichés les plus éculés. Ce qui était certes le but de l'exposition, même si l'on aurait peut-être préféré un peu plus de portraits et un peu moins de clichés.
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/larchitecte-portraits-et-cliches